En ce qui concerne les forêts,
de Lège à Lamothe, d’une part, du Teich à La Teste d’autre part s’échelonnent
de petits massifs isolés qui se développent en général le long des cours d’eau,
ruisseaux, crastes et berles qui drainent la lande et se jettent dans le
bassin. L’enquête réalisée en 1805/1806 permet d’en avoir une idée précise
, tandis que les relevés
des Cassini qui
furent effectués de 1759 à 1789, repris ensuite dans la carte de Belleyme
(1791) permettent d’en connaître les  noms :
noms :
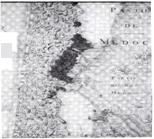
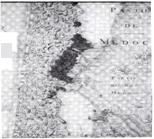 -à
Lacanau :
-à
Lacanau :
Outre la montagne de Lacanau à
l’ouest du lac, dont
Claude Masse en 1708 disait
qu’elle « étoit autrefois
beaucoup plus grande qu’elle
n’est à présent, et
qu’elle se joignoit aux bois qui sont au nord et au
sud », il y a quelques petits massifs sur la rive est,
proches
du bourg, entre Lacanau et
Talaris, et trois
au sud, (Semignan,
Chauconos et Mistres) auxquels
il faut ajouter dans la lande ceux de Narsot, de Méjos Claude Masse,
Montagne
et de Méogas.
de
Lacanau
-à Saumos, quelques bosquets dans les quartiers du grand et du petit Courgas
 -au Porge où la famille de Verthamon possédait,
en 1792, 5000 journaux de landes et pins, existent deux petits massifs
forestiers : l’un est au nord de Lauros,
le long de la craste du Placeou,
l’autre entre l’axe Maisonneuve – Las Vignas et le Porge, est situé dans la
lande déjà drainée par des ruisseaux parallèles qui s’écoulent vers l’ouest à
partir d’un grand ruisseau d’écoulement. Celui-ci décrit un arc de cercle du Pas de bouc jusqu’à l’étang de Batourtat en passant à l’est des hameaux
de Lauros, Larruau, Villeneuve et Lascarran. Plus à l’est se
trouve le bois de Mauluguat
-au Porge où la famille de Verthamon possédait,
en 1792, 5000 journaux de landes et pins, existent deux petits massifs
forestiers : l’un est au nord de Lauros,
le long de la craste du Placeou,
l’autre entre l’axe Maisonneuve – Las Vignas et le Porge, est situé dans la
lande déjà drainée par des ruisseaux parallèles qui s’écoulent vers l’ouest à
partir d’un grand ruisseau d’écoulement. Celui-ci décrit un arc de cercle du Pas de bouc jusqu’à l’étang de Batourtat en passant à l’est des hameaux
de Lauros, Larruau, Villeneuve et Lascarran. Plus à l’est se
trouve le bois de Mauluguat

- à Lège, 7 journaux de «bois et mauvais taillis » (soit 2 hectares
en prenant la valeur du journal local qui était de 28 ares 62 centiares) au sud
de l’église ainsi que 12 journaux (=3,43 hectares) de « bois rabougris, une partie de l’année dans l’eau » sont
possédés par la famille de Verthamon.

-dans l’ensemble formé par les
futures communes d’Arès et d’Andernos,
les forêts produisaient en 1784, 17 milliers de résine soit 8,5 tonnes, et il
existait 700 journaux (223 hectares) de semis non encore en
production. En l’an 14 on y dénombre aussi une garenne de 90
journaux de pins et de chênes (28,7 hectares)
face au château des Belcier
seigneurs d’Arès.
Il y a surtout les 400 journaux
(127 hectares) des pignadas de la « Montagne » qui séparent, le long de
la grande berle ou ruisseau d’Arpech, les deux quartiers d’Arès et
d’Andernos. Ces pins ont été semés au XVII° siècle par le seigneur Pierre Laville
(disparu en 1693) puis concédés en 1702, aux habitants pour leurs usages,
par son fils Jean baptiste Laville. Le
créateur de cette forêt usagère est donc
un des précurseurs de la création de la forêt landaise.
Cette Montagne se prolonge, plus
en amont, par le bois d’Arpech
(estimé à 20 hectares
en 1849) lui aussi sur le Cirès. A
l’intérieur, de petits bosquets dont ceux de la Saugeouse
(la Saussouze),
de Born et de Pichoury qui rompent la
monotonie de la lande.
-en continuant vers Lanton, se trouvaient, sur les bords
du bassin, deux autres petits bois : l’un entre les ruisseaux du Cirès et de Comte, l’autre au  sud du Broustey.
Puis, dans la seigneurie de Certes les 90 journaux du bois de Taussat (22,75 hectares), le long du ruisseau
de Cassis, et le bois du Renet, au bord du ruisseau du même nom.
Ce dernier était un pinhadar de 24 journaux (6,8 hectares) déjà gemmé en 1767,
auquel était adjoint « un petit
bois » dont on peut estimer, vu l’imprécision, qu’il était de chênes.
sud du Broustey.
Puis, dans la seigneurie de Certes les 90 journaux du bois de Taussat (22,75 hectares), le long du ruisseau
de Cassis, et le bois du Renet, au bord du ruisseau du même nom.
Ce dernier était un pinhadar de 24 journaux (6,8 hectares) déjà gemmé en 1767,
auquel était adjoint « un petit
bois » dont on peut estimer, vu l’imprécision, qu’il était de chênes.
-à Audenge, une garenne de bois taillis de 395 journaux (113 hectares),
au Pas du Rey, au nord du château de
Certes, entre les ruisseaux de Lanton et
du Pausaduy. En l’an 10, elle est
signalée comme « forêt de pins ». Un peu plus à l’intérieur au Pas
Simmonet, un pinhadar et deux autres bois encore, l’un sur la berle d’Audenge, au sud-ouest de Saint Yves, l’autre au Vignaud, sur le ruisseau de Paillasse.
Au milieu de la lande, de petits
bosquets isolés comme celui du Gua (2,5 hectares) sur le ruisseau d’Aiguemorte, du Pradeau blanc, du Pujeau (1,7 ha)
,de la Harpe (3.43 ha), de Ménian (2,5 ha) et de Rave (2,80 ha) ainsi que deux bois plus importants,
celui de Cassi à Lanton (25,7 ha) et de Lubec (137 ha). Dans son rapport sur les forêts en
1809, Guyet Laprade, conservateur des forêts, estimera les forêts de Cassy, Lanton et Lubec à
respectivement 50 ha de chênes, 500 ha
dont 148 en taillis de chênes et 50 ha.de pins .
.
-en poursuivant sur Biganos, on rencontrait trois bois sur
le Tagon, l’un à l’embouchure, les
deux autres au sud de Caubet et à La
broustouze.
Ce
dernier dépendait du Prieuré de Comprian
Celui-ci possédait aussi 7 hectares
de pins, à l’est de Facture entre le ruisseau du Lacanau et la route de Bordeaux ainsi que deux bosquets au Peyrat (le houn de la
Peyre ?) et au Plumet
( ?).

La Leyre était bordée par les 250 journaux (71 ha) des bois
de Lamothe, souvent inondés qui
dépendaient du seigneur de certes. En 1809, l’ensemble de ces futaies et
taillis de chênes est estimé à 100 hectares,
puis au Teich, c’était le bois de Ruat, près du château, une
garenne de jeunes chênes, et, au nord-ouest du Bouscau,  un petit pinhadar.
un petit pinhadar.
En remontant la Leyre, à Mios, on peut d’après les cartes
trouver deux îlots forestiers : l’un essentiellement planté de chênes
entre Saint Brice, Arnauton et Coisset, il est limité par le ruisseau
de la Sagenne et par la Leyre ; l’autre sur la rive gauche entre Arnauton, Cazes et Basse cour. L’enquête de l’an 4 estime la forêt à 1100 journaux de
chênes et 100 de pins soit 18,2% du territoire. La population comptait 66
charbonniers qui d’après l’abbé Baurein (1786) envoyaient le charbon de bois
vers Bordeaux, mais devaient en garder une partie pour alimenter les 7
forgerons locaux.
A Salles, on trouve deux ensembles forestiers : sur la rive
droite, un pinhadar qui, vers le sud-est, rejoint le bourg et, vers l’est, la
route Salles-Argilas ; sur la rive gauche la masse importante de la Montagne de
Salles, limitée à l’ouest par les hameaux de Grollet et Caplanne, au
sud par ceux de Bilos et du Lanot, au sud-est par l’église du Vieux Lugos. Elle avoisine les 500 hectares
partagée entre la Seigneurie
de Salles (65%) et la Baronnie de
Lugos (35%)

Au sud du bassin, dans la lande,
s’étendaient les grandes parcelles géométriques de la forêt de Nezer (575 ha) et plus loin, à Gujan, les trois forêts de pins de Mestras (228 ha), La
Ruade et Meyran, auxquelles il
convient d’ajouter les 12 hectares du domaine de Verdalle, à la
Hume, propriété des Verthamon.

Enfin à l’est du bourg de La Teste, le bois de Bordes et au sud les deux bois de Notre Dame des Monts et de la Seuve qui sont les derniers bois avant les deux « montagnes usagères » de La Teste (4000 hectares),
forêt sur dunes anciennes la plus importante
de la région, et d’Arcachon qui en a été séparée à partir
du XVI° siècle par des dunes mobiles
Les forêts qui entourent La Teste en
1781. (Carte de Charlevoix de
Villers)
Des pins et des chênes donc,
plus de pins que de chênes d’ailleurs d’après l’enquête faite auprès des maires
le 1 germinal an 7.
Elle ne concerne malheureusement que les communes de la rive est du bassin et
ses données ne sont pas entièrement fiables à cause de la mesure utilisée, le
journal. Il valait 28 ares 62 centiares à Lège, Biganos et Gujan et donc
vraisemblablement au Teich, mais 31 ares 90 à Andernos (mesure de Castelnau),
23 ares 29 à Salles et Mios et 31 ares 92, mesure de Bordeaux, ailleurs !
Il faut donc en tenir compte pour les conversions en hectares. De plus ces
chiffres sont parfois sous estimés par rapport à ceux dont nous disposions pour
les périodes antérieures.
|
Commune Pins Chênes % du territoire
Le Teich
515,16
400
-
Mios
28,29
232,90 -
Lège
7,15 0 5
Ares-Andernos
31,90 0
3,80
Lanton 57,24 57,24 4,20
Audenge
114,48 0
17,20
Biganos
372,06 6,01 20,60
Le Porge 607
3,22
|
Pour les
communes du sud, il faut utiliser une autre enquête plus tardive de 1827
.Mais les chiffres peuvent
varier selon la conversion en arpents de
Paris, souvent utilisé dans les premiers cadastres (34,19 ares- pour les
communes de Gujan et Biganos) ou en à
Andernos et 1 à Lanton arpents des Eaux
et Forêts (51,70 ares). Ce qui serait logique puisque dans le premiers cas
nous aurions moins de forêts qu’auparavant.
La Teste enquête du 16.06.1827 pins 918 hectares (semis
sur dunes)
+ 4194
(forêt usagère)
Gujan « 25.06.1827 pins 225 ha. dont 7
de taillis
Biganos « 15.06.1825 pins 334 ha.
Lège « 1827 ?
Mios « 31.07.1827 pins 524 ha. + 2167
de taillis + 35 de futaie
Salles pas d’estimation pour les pignadas,
taillis et haute futaie.
Selon Fernand Labatut, les pins et
chênes de la montagne couvraient 3000 ha.
Beliet ? bois 1000 ha.
Belin « 21.07.1827 bois 800 à 1100 ha.
C’est d’ailleurs à La Teste, avec la Grande
Montagne que les emplois forestiers sont les plus
nombreux : 16% des métiers masculins (95 résiniers et 4 scieurs de long)
et 6,3 % des emplois féminins (8 résinières) sans compter les emplois induits.
Ailleurs on ne compte que quelques résiniers à Gujan (1), Lanton(1) et Andernos
(3) et deux scieurs de long à Gujan et Mios tandis que les charbonniers
nombreux à Mios (10) sont
rares ailleurs (1 à Lanton).
Si les bosquets de chênes et de
pins situés le long des cours d’eau étaient souvent des massifs naturels,
nombre d’autres forêts sont issues de plantations :
-la « montagne » d’Arès semée, on l’a dit, par Pierre Laville
au XVII° siècle,
-la forêt du Ponneau, à Facture, par le marquis de Civrac vers 1768/69.
- le bois de Lubec estimé à 137 hectares en 1783 en compte 500
en 1809 dont 148 ha. De taillis de chênes. Même
si le chiffre de 1783 ne concernait que
les pins l’augmentation représenterait 215 hectares.
- quand Marie de Caupos, épouse
de M.de Verthamon, vend, en 1806, sa baronnie d’Andernos,
elle compte « plusieurs pièces en
production de la valeur d’environ 600 hectares » alors qu’en
additionnant les semis de 1784 et les forêts de l’an 7, on arriverait à 254 hectares.
-en sens inverse, Daleau en 1804,
indique que « le pignadar de Gujan
fort de 800 journaux (228 ha.) a été détruit par la lissence de quelques individus dans les temps
affreux de la Terreur »
et qu’il n’y a plus, à Gujan, que 179 hectares de « jeunes pins », ce qui
prouve que des plantations ont été effectuées.
On peut cependant s’étonner que
les forêts n’aient pas été plus étendues
Le sol, plus ou moins marécageux
à cause de la présence discontinue de l’alios, avait besoin d’être assaini mais
les cartes, en particulier celles de Cassini, témoignent de la rareté des
canaux de drainage.
Il y en avait cependant à La Teste où la craste baneyre qui longe la vieille Montagne, large au XVIII° siècle 8 pieds, (avant que Nezer ne la fasse porter à
18 et 20) était entretenue par la communauté des habitants. Elle se prolongeait
jusqu’au bassin par la craste de La Hume, tandis
que la grande craste commune au sud
de Gujan et du Teich, rejoignait la Leyre.
Il y en avait surtout un réseau
assez dense dans le quadrilatère limité par les paroisses de Sainte Hélène, Lacanau, Saumos et Le Porge. En
1780, le curé du Porge parle de ces « fossés »
dont les propriétaires des terres traversées doivent payer le « récurrement »
Mais ailleurs, seuls les
ruisseaux naturels drainent ces immenses territoires.
Plus tard, au XIX° siècle, le
baron d’Haussez, Crouzet et Chambrelent agiront pour systématiser ces
traditions déjà anciennes dont Desbiey avait déjà préconisé le développement en
1776.
2. LE STATUT JURIDIQUE, OBSTACLE AUX PLANTATIONS
Mais la véritable raison de
cette situation, c’est le statut juridique de ces terrains de landes non
cultivées, vouées au pâturage, qu’on appelait les padouens et vacants Ils
étaient en effet soumis à des droits d’usage au profit des habitants, ces « libertés » dont les cahiers de
doléances en 1789 exigeront le maintien.
En 1506, le 30 juin, le seigneur
Jean Durfort de Duras avait confirmé aux habitants leurs droits antérieurs sur
les vacants d’Andernos et Arès : droits de pacage, d’ajoncs, de bruc (la
bruyère) et d’apiés (les ruchers).
Renouvelés en 1619 par Gabriel Dalesme puis en 1702 par Jean Baptiste de
Laville, ils étaient toujours en vigueur en 1792 et concernaient 40000 journaux
de landes (12760 ha.) propriété de Belcier,
auxquels il faut ajouter les 1950 journaux (622 ha.) propriété de la
communauté d’Andernos. Ces droits avaient souvent une contrepartie, ainsi à
Arès en, 1730, le padouentage était accordé contre une taxe de 4 livres par centaine de chèvres
ou de brebis.
En 1550,le 23 mai, dans le Captalat de Buch , Frédéric de Foix
reconnaît le droits des « manants et
habitants sur tout ce qui est accoutumé être tenu en padouens et vacants
esdites paroisses de La Teste, Gujan et
Cazaux ».Ces droits , dont il était déjà question en 1500
consistaient essentiellement en « herbatge».Ils
concernaient, au moment de la Révolution, près de 22000 journaux soit 7029 hectares car il y avait, en plus des
landes, « les vacants », c'est-à-dire les dunes et les prés salés.
En ce qui concernait plus
précisément les lettes, vallées humides entre les dunes, le Captal de Ruat, en
1742 et 1743 , y permettait le pacage, tout en se réservant le droit de
révoquer l’autorisation à sa guise (quand il concédait par exemple des « lacs d’eau douce » pour la chasse),
il avait fixé é le tarif à 3 ou 1 sols selon qu’il s’agissait de « gros ou de menu » bétail,
puis à 2 sols par brebis et 5 sols par vache ou jument, à charge pour
l’utilisateur de déclarer le nombre de têtes de bétail.
En 1561, le 3 novembre, ce sont
les habitants de Salles qui obtiennent,
de leur Seigneur Pierre de Lur, vicomte d’Uza le droit de « faire paccager les bestiaux et faire leurs
coyallas, dans toute l’étendue des landes, et couper bruc, brande, jaugue et
fougère »
En 1571, le 6 avril, dans le domaine de Certes, Isabelle de Savoie accorde le droit de pacage mais le
limite au nombre d’animaux nécessaires à la production d’engrais. Ces
dispositions sont confirmées en 1736 par Eymeri de Durfort, marquis de Civrac, au
moyen de trois textes distincts concernant Biganos,
Audenge et Lanton.
Que représentaient ces vacants/ Il est difficile de le dire.
L’estimation de 1782/84 est de 240000 arpents ; convertis d’après les
indications de Brémontier sur les mesures en usage à La Teste, cela
donne 120 000 hectares ! par contre, s’il s’agit de l’arpent de Paris, mesure utilisée par
les cadastres au tout début du XIX° siècle, cela donne 81600 hectares. On est de toute
façon encore loin de l’estimation du notaire testerin Eymeric qui compte 9500
journaux (soit 2717 hectares, le journal valant
28,62 ares d’Andernos à Biganos).
La comparaison avec deux autres chiffres : la superficie
des landes dans les trois communes de Lanton, Audenge et Biganos en 1843 (246556 ha.) et la superficie
cumulée des 3 communes (29556 ha.) montre bien qu’aucune
des estimations du XVIII° siècle n’est fiable. Par contre en additionnant
toutes les landes de Certes vendues
ou partagées sous la Révolution,
on obtient 20036 hectares, ce qui semble plus
proche de la réalité.
Il y en avait aussi 4900 hectares à Mios où des droits de pacage étaient
aussi en vigueur en 1736, la communauté pouvant utiliser « les landes vacantes et padouens », y ramasser jaugues
et bruyères contre un droit de civadage
de 5 sols par an et par feu vif.
Certes les seigneurs se réservaient en général le droit de « bailler » ces terres à ceux
qui « en voudront convertir en
labourage pour y faire bled » comme dans le Captalat de Buch, mais la
pauvreté du sol et la force des habitudes avaient limité cette possibilité, de
plus ces landes et vacants étaient indispensables car terrains de parcours pour
le bétail : 6000 têtes de bétail à Gujan (surtout des ovins) et 2000 à La
Teste (bovins mais aussi chevaux, au nombre de 146 en 1754.) 700
têtes au Teich dont 1600 brebis appartenant à Ruat en 1775.
Pourtant les conflits étaient fréquents, nombre de seigneurs essayant, surtout
au XVIII° siècle de rogner les avantages acquis.
Quant aux forêts, elles étaient
aussi frappées de droits d’usage : droit d’affouage , « feussatge » sur le bois
d’œuvre et de chauffage dans les montagnes d’Arès, La Teste et Lacanau, de chauffage à Lanton et, un peu
partout, le droit de prendre des glands,» « glandatge »
pour nourrir les porcs (ou les hommes en temps de disette), comme dans le
Captalat entre la Saint Michel et la Saint André, ou bien encore le droit
d’ « ombrage »
institué à Salles en 1581 qui
permettait aux bestiaux de circuler dans deux bois. Ce droit avait été accordé
par Louis Duluc, vicomte d’Uza, le 3 novembre 1561 : « ne pourra ledit seigneur, pignorer ni prendre aucun
bétail des habitants de Salles trouvés en ses bois seigneuriaux et prés, ni en
faire payer aucune amende en aucun temps »
Ces droits interdisaient la
pratique des clôtures (c’est toujours en vigueur dans la montagne de La Teste) et
limitaient l’extension des forêts car les seigneurs n’en avaient pas la libre
disposition. Mais c’était aussi un moyen de fixer les populations, d’en attirer
de nouvelles et d’augmenter les revenus seigneuriaux puisque tous ces droits,
qu’ils concernent la lande ou les forêts, étaient accordés contre « espèces
sonnantes et trébuchantes ».
Leurs montants étaient parfois
réévalués pour tenir compte de l’érosion monétaire. Cela donnait lieu à des
conflits et à la signature de nouvelles transactions, mais les sommes restaient
souvent symboliques à cause justement de cette érosion monétaire. C’est ainsi
qu’à Salles, la charge monétaire
moyenne à l’hectare, en argent, grains et volailles, était de 0,414 % et sur
les forêts elle n’y représentait que 1,8 % du produit net moyen.
Le meilleur exemple de la
difficulté d’étendre le domaine forestier à cause des droits d’usage sur la
lande est celui de La Teste.
Vers 1746, Jean Baptiste Amanieu
de Ruat et « quelques habitants
s’occupèrent à faire semer des graines de pins, d’ajoncs, ronces et de genêts…
elles prirent très bien et dans peu d’années , dans cette partie semée, les
sables se trouvèrent fixés et arrêtés et, étant devenus grands et presqu’assez
pour être exploités, pour produire des gommes, quelqu’un par malice ou sous
prétexte qu’il ne pouvait pas faire paccager son bétail, les incendia, ce qui
fut cause qu’on cessa cette plantation, crainte d’éprouver le même sort» Ruat, dans un
mémoire adressé à M.de Saint Maur en 1776, affirme qu’ils ont eu lieu, 40 ans
plus tôt, soit en 1736 et Charlevoix de Villiers écrit en 1778 que l’incendie
s’est produit au bout de 15 ans, soit en 1751. Dans les deux cas, il s’agit de
vacants situés dans les dunes et dans le second il est précisé qu’il s’agissait
de terrains situé au pied des sables issus de la mer. Un autre incendie s’est
aussi produit le 31 août 1733, des semis ayant été détruits au lieu dit Birehuc, « à l’orée de la grande forêt »donc à l’est de celle-ci,
dans la lande, près du chemin qui allait à Cazaux, le lieu-dit s’appelle de nos
jours le Becquet. Les
historiens locaux, dont moi-même à leur suite, ont parfois confondu les deux.
Il s’agissait en fait de
réactions tardives à la violation par le captal de la baillette de 1550 qui ne
prévoyait que deux possibilités pour bailler
les vacants dunaires ou la lande : « bâtir moulins à vent » et « convertir en labourage pour faire bled ».
C’est pour la
même raison que le suisse Nezer ne put semer des forêts que dans les landes du
Teich. Il avait pourtant acheté, le 5 février 1766, à François Alain Amanieu de
Ruat « landes vacantes, terres
incultes et en friche dépendant de ses terres en seigneurie de La Teste et du
Teich…le tout formant quarante mille journaux…dont vingt mille deux cent
quarante huit dans la Seigneurie
du Teich et dix neuf mille sept cent cinquante dans l’étendue de la terre et
seigneurie du Captalat, distraction faite des trois cent trente deux journaux à
quoi s’élèvent pareillement les concessions ci-devant faites par le dit
Seigneur de Ruat »
Si Nezer, ses associés et
ayant-droits, pouvaient « disposer à leur gré » des landes du Teich
où 786 hectares furent ensemencés, la
forêt étant dessinée par le géomètre Clavaux, il était précisé dans l’accord
que pour celles de La Teste, Gujan et
Cazaux, ils ne pourraient les convertir « qu’en terres labourables, vignes, prairies, bâtiment, parcs et autres
objets de cette nature, sans pouvoir cependant y semer aucune espèce de bois,
attendu que les habitants de ces trois paroisses doivent avoir l’usage desdites
landes pour leur pacage tout autant qu’elles ne seront pas défrichées et mises
en valeur de la manière qui vient d’être expliquée. »
Malgré ces précisions, les
habitants firent appel car il ne leur restait plus que 788 hectares de landes usagères. Bien
que l’accord fut entériné par le Parlement de Bordeaux, ils obtinrent cependant
en 1767 que soit interdit à Nezer d’utiliser le bois de la forêt usagère pour
établir ses « pressoirs, foulons,
papeterie, fabriques, manufactures et généralement tous autres établissements» le privant ainsi
de combustible. L’expérience fut donc stoppée, la Compagnie
fit faillite en 1769 et Nezer mourut ruiné le 8 avril 1770.
3. LES TENTATIVES DE COLONISATION DE LA LANDE dans la
seconde moitié du XVIII° siècle.
Ce n’était pas le premier à
avoir tenté de coloniser la lande, car, malgré les difficultés, les projets
fleurissent.
En 1758, le Sieur Laugeay de
Beaune qui se décrit lui-même comme » un homme non ambitieux mais qui a
besoin de s’occuper utilement »propose à l’intendant Tourny de
s’occuper du défrichement des landes appartenant au Roi entre La Teste,
Bordeaux et Bayonne ! Il aurait institué une corvée, chaque laboureur
défrichant 2 à 3 journaux et payant un droit d’entrée de 3 livres par journal et une rente de 5 sols par
an, lui-même « pouvant en prendre à
sa bienséance mais sans droit d’entrée… »aux mêmes conditions de
rente.
En 1759, c’est la Marquis de
Beaumont qui demande la concession des landes entre Bordeaux et Auch !!
Comme il est appuyé par le contrôleur général du royaume,
Tourny insiste sur le travail de recensement nécessaire. Le bailli de Lesparre,
Bastert, chargé de l’inventaire entre Le Verdon et La Teste, précise
que les landes ne sont pas au Roi.
Tourny répond donc que les syndics ou consuls ne connaissent point
l’étendue des landes, ne peuvent distinguer celles du Roi de celles des
seigneurs et que ce sont des communaux nécessaires à l’engrais. Il demande le
10 août 1759 au contrôleur général si le Roi veut faire un arpentage et des
sondages dans tous ces territoires, ce qui clôt l’affaire.
En 1760, c’est au tour de Raymond de Bellegarde d’obtenir un arrêt
favorable du Conseil du Roi concernant les Landes de Bordeaux mais le projet
n’eut pas plus de succès.
En 1761, le Conseil, confirmant le texte de 1669, apporte quelques
encouragements aux défricheurs et, le 1 juin 1762, ce sont les Lettres patentes
royales qui
accordent 20 ans d’exemption de dîme, 40 ans d’exemption de franc fief et la
réduction d’un centième du denier.
Il s’agissait de favoriser les
entreprises des sieurs Vallet de Sallignac, De Chazelle et De Mariencourt qui
venaient d’obtenir du Marquis de Civrac la concession de 240.000 arpents de
landes. L’intendant Boutin ne cacha pas son scepticisme et
accumula les arguments : terres stériles, eaux stagnantes et donc
habitants accablés d’infirmités, nécessité de « briser l’alioste » pour faire des puits à grande
profondeur et des canaux. Il donna cependant son accord pour les privilèges
accordés, ajoutant, perfide, que l’Etat n’y perdra rien puisque ces fonds ne
rapportent rien.
Les 1700 métairies prévues ne
virent pas le jour, De Sallignac quitta le royaume et Civrac ne put récupérer
ses terres qu’en 1765.
EN 1765, c’est une autre compagnie ; Rothe, directeur de la
précédente associé à De Cléonard qui reprend le projet, là encore sans succès.
Les amateurs pourtant ne
manquent pas : en mars 1764,
c’est un magistrat d’Auch, Ferraguet, qui se porte candidat.
Le 2 mai 1765, c’est un allemand appuyé par D’Ormesson et Choiseul qui propose
l’installation de compatriotes (700 familles) qui devaient aller sur Cayenne et
qui sont libres. L’intendant Boutin approuve le 17 août, mais, comme cela
dépendait du succès de la compagnie Rothe, cela ne se fit pas. Il insistait
aussi sur la nécessaire satisfaction par l’Etat des demandes des promoteurs de
l’opération. Ceux-ci espéraient pouvoir y installer des irlandais catholiques
persécutés: pour chaque groupe de 5
personnes, des hardes pour une valeur de 100 livres,30 outils aratoires et ménagers, 60
meubles et ustensiles, une maison de 150 livres, un puits pour deux maisons et 6
brebis, le tout pour un montant de 436 livres par groupe.
Mais là encore l’aide ne vint
pas.
Les années suivantes voient se
multiplier les Arrêts du Conseil et les Lettres patentes pour accorder plus de
privilèges aux défricheurs.
Le 4 décembre 1785, c’est en faveur de Ruat afin
de faciliter la tentative de Nezer : les avantages sont semblables à ceux
accordés à Sallignac mais on y trouve aussi une exemption de taille et de
vingtième pendant 40 ans, une réduction à 20 sols de la capitation pout les
colons, la réduction de la dîme à une gerbe sur 50, et
la naturalisation des étrangers au bout de trois ans de présence.
Des dispositions semblables
seront généralisées par l’Arrêt de Compiègne du 13 août 1766 puis améliorés, en ce qui concerne les « landes de
Bordeaux » par les lettres parentes du 29 avril 1768. Ce dernier texte essaie d’unifier les différentes mesures
particulières et prévoit des exemptions (dîme, taille, vingtième pendant 20
ans, franc fief pendant 40 ans) ou des
réductions (dîme à la 50° gerbe pendant 40 ans, 1 denier par arpent
d’insinuation si le bail dépasse 29 ans, capitation de 20 sols par colon.
C’est surtout cela qui importait : comme le signalait
l’intendant Farges, le 20 février 1762, si 28715 arpents avaient déjà été
défrichés sur les landes de Nezer et de Civrac, aucun étranger ne s’était
installé. Il demande en particulier qu’on valide leurs mariages antérieurs ou
futurs et qu’on leur donne l’autorisation de tester et de succéder quelle que
soit leur religion. Le but était d’attirer des suisses de la région de
Neufchâteau.
Si tout cela ne servit pas, cela
montre au moins qu’en cette fin du XVIII° siècle, les aides à l’emploi
prolifèrent déjà mais surtout que l’esprit de tolérance a déjà gagné les
milieux officiels et que « l’étranger », c’est d’ailleurs une
tradition sous l’Ancien Régime, ne fait pas peur.
D’ailleurs à partir de 1768,
l’attention se porte plutôt sur les problèmes de navigation et les projets de
canaux se multiplient comme préalables au défrichement et à la mise en culture
de la lande, le lien étant, on le verra, souvent fait avec la fixation des
dunes.
Il s’agit de creuser un futur
« canal des étangs » de la Gironde à
l’Adour, même si certains projets envisagent des dérivations vers la Garonne. Se
succèdent donc le rapport de M.
Chevallier, avocat au Parlement, (1770-72) qui s’inspire de celui de M. De Karnay (vers 1768) et préconise, comme lui, la fixation préalable
des dunes ; l’inspection de l’intendant Boutin accompagné de M.
Desmarets, membre de l’Académie royale de Paris, et de l’abbé Desbiey (1769) ; le projet
du  Comte
de Montauzier auquel est associé
Clavaux (1773), ce projet appuyé par Desbiey fut refusé par Brémontier qui,
depuis 1770, était en poste à Bordeaux ; la lecture en séance publique de
l’Académie de Bordeaux du mémoire des frères Louis Mathieu et Guillaume Desbiey « Sur l’origine des sables de nos côtes et les moyens de les
fixer » ; le projet d’un canal de Bègles à Arcachon par Péconnet (1775) qui reçut un avis
défavorable de Turgot ; le mémoire de Guillaume
Desbiey « Sur la meilleure
manière de tirer parti des landes de Bordeaux » (1776) ; celui de
Lorthe sur un canal Garonne-Arcachon-Adour
accompagné d’un port à Arcachon, projet autorisé par Louis XVI mais abandonné
faute d’argent ; celui, enfin, d’un certain Ferbaux sur le canal Bordeaux-Bayonne que l’intendant Saint Maur
refusa (1777).
Comte
de Montauzier auquel est associé
Clavaux (1773), ce projet appuyé par Desbiey fut refusé par Brémontier qui,
depuis 1770, était en poste à Bordeaux ; la lecture en séance publique de
l’Académie de Bordeaux du mémoire des frères Louis Mathieu et Guillaume Desbiey « Sur l’origine des sables de nos côtes et les moyens de les
fixer » ; le projet d’un canal de Bègles à Arcachon par Péconnet (1775) qui reçut un avis
défavorable de Turgot ; le mémoire de Guillaume
Desbiey « Sur la meilleure
manière de tirer parti des landes de Bordeaux » (1776) ; celui de
Lorthe sur un canal Garonne-Arcachon-Adour
accompagné d’un port à Arcachon, projet autorisé par Louis XVI mais abandonné
faute d’argent ; celui, enfin, d’un certain Ferbaux sur le canal Bordeaux-Bayonne que l’intendant Saint Maur
refusa (1777).
Beaucoup plus sérieux furent les
travaux menés par l’Ingénieur du Roi, Charlevoix
de Villers
en 1778 à La Teste. Dans ses cinq rapports, dont le dernier fut remis en 1781,
avant son retour à Saint Domingue, il envisage tout ce qui se fera plus
tard : la fixation des dunes et ses
techniques, « utilisées » plus tard par Brémontier, le percement
de canaux entre les étangs, le développement des crastes pour drainer la lande,
la plantation de pins dans les zones impropres aux autres cultures, le
développement des prairies artificielles pour accroître le rendement du
bétail….Bref un visionnaire abondamment utilisé et donc souvent oublié, mais
aussi un homme d’affaires se mettant à dos la population, outrepassant souvent
sa mission et l’abandonnant au profit d’un projet d’endiguement des prés salés
par la compagnie du Sieur Gier, qui en avait obtenu la concession en 1780,
entreprise à laquelle il aurait été intéressé et qui lui valut sa disgrâce.
Charlevoix de Villers : Projet de canal
entre La Teste et Cazaux
Dans les années qui suivirent,
on reparla encore du canal avec le projet Chevalier-Duplessis de 1782, mais il
est là encore refusé par Dupré de Saint Maur car les priorités ont
change : ce sont désormais les dunes qui retiennent l’attention.
Cette prolifération de projets
témoigne de la vigueur de l’esprit physiocratique dans les élites locales de la
fin du siècle. Ce=t esprit nouveau attira dans la région nombre de promoteurs
aussi enthousiastes que malheureusement désargentés.
Donc la lande resta presque
partout vaine, jusqu’à ce que la Révolution et des années de procédures règlent
la question du droit de propriété et des droits d’usage ce qui ne calma pas les
porteurs d’idées nouvelles à preuve les mémoires adressées en 1809 par Paul
Courbin de Mios qui demandait la concession de toutes les terres vaines et
vagues appartenant à l’Etat depuis l’estuaire de la Gironde
jusqu’à…Bayonne !!!
4. LE PARTAGE DE LA LANDE
Le sort des terres vaines
situées en arrière des dunes ne fut pas réglé facilement. D’après les lois des
14 aout 1792 et 10 juin 1793, complétées en février 1804, et en vertu de
l’abolition de la féodalité, les communes étaient considérées comme
propriétaires des landes et vacants, à condition que les anciens seigneurs,
leurs héritiers ou leur successeurs ne puissent prouver qu’ils les avaient
régulièrement achetées.
Les communes avaient la
possibilité de partager ces vacants entre les habitants contre une somme
calculée sur leur revenu au moment du partage. Cela, certains n’ayant pas
attendu les partages officiels, provoqua maintes querelles.
A cela s’ajoutaient les terrains
qui, pour cause d’immigration ou de condamnation de leurs propriétaires,
avaient été confisqués par la Nation et
revendus comme biens nationaux. Enfin, tout était compliqué par l’existence de
droits d’usage, de chasse, de parcours ou de pacage non abolis.
Le début du XIX) siècle est donc
fertile en contestations et procès qui finirent par aboutir à des partages plus
ou moins amiables. Mais il faudra attendre les lois de 1857 enjoignant aux
communes de vendre leurs communaux pour les ensemencer en pins, pour voir la
lande se couvrir presqu’entièrement de forêts.
Au TEICH, tout avait été vendu à Nezer.
A GUJAN et à LA TESTE, 2464
journaux (786 hectares) avaient été réservés
à Ruat et donc aux habitants pour y exercer leurs droits lors de la vente de
1766 « dix neuf mille sept
cent cinquante et un journaux vingt cinq règes sept carreaux sur vingt
deux mille deux cent quinze journaux une rège cinq carreaux à prendre dans l’étendue de la Terre et
Seigneurie du Captalat de La Teste, dont le
surplus est réservé au dit Seigneur de Ruat. »
Sur ce total, 1012 revenaient à
la commune de Gujan soit 323 hectares. Les partages y
commencèrent en 1806 mais ce n’est qu’en 1823, le 2 avril, après des années de
contestations diverses, qu’une Ordonnance Royale conclut l’affaire : un
peu plus de hectares avaient été concédés à des habitants et mis en culture.
Le premier partage avait eu lieu
en septembre 1793 puis annulé parce que contesté ; il fut refait en
décembre mais, en 1802, le Conseil Municipal, saisi par des habitants, demanda
que la lande soit remise en l’état antérieur à la Révolution
car il n’y avait plus assez de pâturages pour les troupeaux. La loi de 1804 ne
reconnaissant comme privées que les parcelles qui avaient été défrichées, il
fut donc attribué, le 17 avril 1806, une superficie de 80 hectares à 80
personnes. Ce n’était pourtant pas réglé, certains continuaient à défricher
sans titres, d’autres détournaient des crastes, inondant leurs voisins et le
quartier de Mestras revendiquait ses droits sur un communal particulier. Le
Conseil, d’abord opposé à de nouvelles concessions changea d’avis à cause de la
misère mais, les lenteurs administratives s’y ajoutant, il fallut donc 30 ans
pour régler la situation.
Quant au reste, situé sur la
commune de La Teste,
l’ancienne paroisse de Cazaux ayant demandé son rattachement, il se passa
longtemps avant que n’y poussent des forêts. Les successeurs de Nezer,
Gaullieur-L’Hardy et Bessac-Lamegie apportèrent, en 1817, leurs 11 674 hectares à la Compagnie
Agricole et Industrielle d’Arcachon qui envisageaient une
mise en culture, profitant de la construction du canal Cazaux-La Hume commencée
en 1835.
Mais il n’y eu toujours pas de
forêts, la baillette de 1500 et le Maire de La Teste s’y
opposant. Après la faillite de l’entreprise, en 1846, et la création d’une
éphémère Compagnie Ouvrière de colonisation des landes de Bordeaux en 1847, le
terrain retourna à la lande.
Le tableau ci-dessous donne en
ce qui concerne le sud-bassin, le bilan en hectares des landes communales (en italiques) et privées dans la
première moitié du siècle. Quand le chiffre est en gras, il représente le
total. Les chiffres varient selon qu’il s’agit des estimations des Maires ou
des relevés cadastraux; quant à celui de 1857, il s’agit des surfaces communales
à ensemencer inventoriées par Chambrelent.
|
Communes 1827 I843 I852 I857
La Teste 9-
4420 4430
0
Gujan 1203- 90 338-3183 221-3135 0
Le Teich 1839-4541 628 1,27
Total du canton
Communales et privées)
14331 13118
|
Ce tableau appelle trois
remarques :
-
pour l’enquête de 1827, il faut, pour Gujan, ajouter
les landes de Nezer estimées en 1819 à 50 hectares.
-
Sur les 221 hectares portées sur le
cadastre impérial de 1852 et situées entre la craste baneyre et les villages, 6 hectares sont attribuées, à La Hume, « aux habitants » et 135 au « village de Mestras »
le reste étant mentionné comme « lande
communale » Ces terrains, voués au pacage sont donc naturellement
exclus par Chambrelent, de la liste des espaces à boiser.
-
-A La Teste
pratiquement toute la lande appartient aux ayant-droits des compagnies, il est donc normal qu’elle n’apparaisse pas en 1857.
Dans le canton d’Audenge, le
partage des landes eut lieu en 1846 entre d’une part les communes de Biganos et Lanton qui obtinrent
respectivement 681 et 5275 hectares et, d’autre part,
les héritiers Civrac qui en récupérèrent 712 et 5099 hectares. Les possessions du
domaine de Certes avaient déjà été
amputées en 1797/98 par des ventes à Biganos (457 hectares cédés à la famille
Turgan, propriétaires depuis 1787, puis rachetés par Guestier et Darrieux qui
furent en procès avec la commune en 1835) et à Lanton (250 hectares à Darrieux et 200 à
Deloutre qui en revendirent 113 à Etienne Anglas en 1818,
« Les landes Bettereau ». Lors du procès de 1835, LA Cour d’Appel,
précisa que la présomption de propriété des communes en vertu des lois
révolutionnaires « sur les terres
vaines et vagues situées sur leur territoire, cesse d’avoir son effet si les
ci-devant seigneurs ou leurs représentants
justifient, par des actes authentiques, qu’ils les ont légitimement
acquises. » ce qui était le cas pour les terres du marquis de Civrac
depuis 1636.
Par contre à Audenge, les héritiers Civrac n’ayant
pu fournir de titre de propriété, c’est la commune qui récupéra le tout, 5000 hectares qui s’ajoutèrent aux
162 qu’elle possédait depuis 1768. La contestation ne portait que sur ce qui
restait après la vente en 1798 de 1450 hectares du domaine de Certes
à Dauberval Ils furent revendus en 1818 à François de Boissières dont le fils
Valeton de Boissières draina vers 1843/44 une partie des landes après en avoir
semé 55 hectares en 1855.
A Mios, comme il n’y avait pas eu de vente en 1798, c’est par contre
la totalité des biens de Civrac qui furent partagés entre la commune (2390 hectares) et ses héritiers (2512 ha).
A Ares, le domaine de Belcier ayant été vendu en 1798 à Duprada puis
à Hirribarne, c’est en1847 que son successeur Javal commença à effectuer des
semis car les droits de parcours étaient éteints depuis 1789 comme le reconnut
un jugement de…1851.
A Lège enfin, les landes avaient appartenu à M.de Marbotin qui
n’avait pas émigré et fut inscrit en 1791 et 1792 sur les rôles de la
contribution foncière, preuve de la reconnaissance par la commune de ses titres
de propriété. C’est pourquoi celle-ci fut déboutée dans sa revendication de
propriété, le 12 janvier 1826 par la Cour Royale
de Bordeaux. Les héritiers de Marbottin, disparu en 1793, vendirent la
propriété à la « Société pour la mise e, valeur des Landes de Gascogne du
négociant bordelais Adolphe Seigneur Balguerie.
La répartition des landes
communales et privées s’établit donc selon le tableau suivant avec les mêmes
réserves que pour le précédent.
|
Communes An 7 1827 1843 I852 I857
Biganos 3972 935/954 2719/2807 5623 1105
Audenge 40 3610/2625 6732 3516
Lanton 2289 11116/
91 12012 4726
Andernos-Ares 382 0/5542 1648 711
Ares
3892 1798
Lège
851 0/7711 2009
CANTON 37582 32811
Mios 931 6072/2167 4866/5297 2282
Salles 7483
4500/3000 8071 4357
Beliet
3500 2825/ 224 379
Le Porge 5745
5548/1168 3957
|
Comme on l’a vu précédemment,
les réponses de Maires à l’enquête de l’an 7 ne sont pas fiables, mais on leur
demandait d’estimer des
« pâturages » ;
Il est d’autre part intéressant
de montrer quel est, vers 1850, le pourcentage de landes par rapport au reste
du territoire et aux forêts, leur superficie en hectares et quel est, dans
chaque secteur, le nombre de parcelles. Les calculs que j’ai effectués sur les
matrices cadastrales donnent les résultats suivants ;
|
Communes % de taillis ou bois
taillis nb de parcelles pins % landes %
Biganos 5,56 288 168 5,14 692 74,98
Audenge 6,78 248 106 3,69 321 83,15
Lanton 3,00 165 218 2,15 606 89,38
Andernos 1,77
34
60 11,40 161 74,85
Ares 2,16
43
49 5,26 87 84,79
Lège (sans les dunes) 1,30
81 86 1,90 162 87,07
Le Teich 6,43
195
28 37 53 7,25
Salles 6,40
604 1628 I9,98 1151 59,24
Mios 11,54
1658 985 3,35 2627 78,67
|
Nous pouvons constater un très
grand morcellement du parcellaire qui ne signifie pas toujours un éparpillement
de la propriété. Celle-ci est particulièrement concentrée comme le montre le
tableau suivant où j’ai classé les communes en fonction de l’importance des
grandes propriétés privées de landes.
|
Commune Superficie/ propriétés de + 100 ha. § // à la propriété nom des grands superficie possédée
à celle de la
commune privée totale propriétaires
Lège
7604
98,71 Balguerie 7500
Desplanche
105
Gujan 338 3034
95,28
Degruhère
3034
La Teste
4125 93,09 Cie Nezer 4125
Le Teich 1839 4150 91,38 « 4060
De Lauzac
91
Andernos
5160
90,39
Balguerie
3374
De Sauvage 1480
Vve Sutton 507
Audenge 3610 5789
68,84 De
Boissière 1458
Hazera 516
Dumora 208
Mios 4865 1988 37,53 Lacouen 1072
Garnung 580
Courbin
F. 176
Mano 140
Biganos 3276 467 20,95 Dumora 326
Dubourg 142
Lanton 11116 189 20,65 Argilas 189
Le Porge 5325
Bacquey Jeune 21
Digneau
Jeantet 19
Salles 6924
Cazauvielh
Arn. 53
Brun Arnaud 73
|
On constate donc qu’en dehors de
Mios-Biganos ou Lanton où la grande propriété est minoritaire, il y a deux
communes où elle est pratiquement inexistante, Salles et Mios parce que les
communes y possèdent respectivement 93 % et 76% des landes. Mais partout ailleurs
c’est le règne de la grande propriété
Comment a-t-elle évolué, les
propriétaires l’ont-ils boisée, c’est ce que vont nous apprendre l’examen des
cadastres dits « impériaux » au milieu du XIX° siècle. C’est en effet
l’examen des matrices cadastrales qui permet d’avoir une vision précise des
forêts existantes dans chaque commune, à l’exclusion des semis sur dunes qui
feront l’objet de la seconde parte.
5. LE BOISEMENT DE LA LANDE AU
MILIEU DU XIX°SIECLE
Les communes du sud
LA TESTE
En 1849, le bourg est entouré
d’îlots forestiers :
A l’est, dans la section dite de
Bordes, il y a 68 hectares de pins divisés en 28 parcelles dont 15 ont plus de 1 ha.de superficie et 3 plus de
10. Là domine la pinède bien nommée de l’enclos du ping avec ses 16
parcelles totalisant 58 ha. Et quelques petits bois à Petit Bordes (1), Caillivole (2) et la
Hume (4).
Il faut aussi y ajouter les 138 ha. du bois de Bordes.
Au sud et au sud ouest, ce sont
les pins de la lède de la
seuve (24 ha dont 20 partagés entre deux
propriétaire : Dubos et Hameau), ceux des Ninots
(4 ha. aux Caupos) et ceux de Notre Dame des Monts (22 ha. En 5 parcelles :
Bestaven, Caupos, Lalesque, Marichon, Moyzès) soit 42 hectares de pins auxquels se
mêlent 6 hectares de bois.
A l’ouest, enfin, le petit bois
dit du Braouet s’étend sur un peu
plus de 1 hectare avec 4 parcelles à
Peyjehan et Hameau.
Le reste des plantations de pins
se trouve plus au sud dans les domaines appartenant à la Compagnie
du canal (32 ha.) et à la Compagnie Agricole
d’Arcachon (42 ha.). Au total la lande ne
comporte que 76 hectares de pins, le reste a
été converti en cultures diverses qui toutes échoueront ou laissé en friche. Un
chiffre témoigne de ces échecs, celui de 1892 : il y a encore 1544 ha.de landes dans la commune
ce qui prouve que les terrains cultivés y sont retournés.
Quant à la répartition sociale,
elle respecte dirais-je la tradition :en dehors des Compagnies, rêves de
bordelais ou d’aristocrates piqués d’agronomie, c’est la bourgeoisie locale qui
concentre en ses mains la propriété foncière, c’est  aussi le cas dans les 4183 hectares de la
forêt usagère, la Montagne,
mais ce n’est pas le cas, on le verra, dans les dunes nouvellement semées qui
totalisent déjà 3557 hectares à La Teste et 854 au
Cap Ferret, à l’époque quartier de La Teste
aussi le cas dans les 4183 hectares de la
forêt usagère, la Montagne,
mais ce n’est pas le cas, on le verra, dans les dunes nouvellement semées qui
totalisent déjà 3557 hectares à La Teste et 854 au
Cap Ferret, à l’époque quartier de La Teste
Un exemple de rêve,
celui de la « Compagnie
d’Arcachon » dont les domaines jouxtaient à l’est, hors du Captalat, les
semis de la compagnie de Nezer.
La baillette de 1550 interdisant la plantation de pins, différentes
cultures furent envisagée : des pommes de terre, du colza, du maïs et
diverses céréales, et aussi des mûriers pour l’élevage des vers à soie.
Mais l’aridité du sol, le manque d’eau malgré les espoirs nés de la
construction du canal, l’inexpérience pratique des « directeurs »
eurent raison de l’enthousiasme des promoteurs.
Après la liquidation de la
compagnie, d’autres essais furent tentés
comme la riziculture et une autre utopie vit le jour, celle d’employer des
chômeurs, conçue par un des anciens
directeurs le Comte de Blacas Carros qui créa l’éphémère « Compagnie de colonisation des Landes
de Gascogne ».
GUJAN : Dans cette autre commune de
l’ancien Captalat de Buch, la comparaison entre les chiffres de 1827 et ceux du
cadastre impérial, établi vers 1850, montre peu de changements hors l’action,
comme à La Teste, de
l’action des Compagnies du canal et de la Compagnie
agricole d’Arcachon. Elles totalisent 72 hectares dont deux parcelles de
39 et 30 ha. à La
Hume qui s’ajoutent aux 15 hectares des « pins Dejean ».
Quelques gros îlots dans la
lande : une trentaine d’hectares à La Ferme, au
comte d’Oyzonville, et à Taurès à M.
Vinzelle, soit en tout 117 hectares de pins partagés
entre 5 propriétaires.
Pour le reste, on arrive à un
total de 149 hectares, identique, à celui
de 1827, répartis en 200 parcelles soit une moyenne de 74 ares chacune.
Il y a donc une nette opposition
entre quelques gros propriétaires et une foule de petits propriétaires
exploitant, près des bourgs, les mêmes superficies que 25 ans plus tôt, sans
chercher à les augmenter, car le vignoble, certainement plus rentable, se
partage, avec les cultures, la plus grande partie de ces zones où l’on ne
trouve que très peu de landes, seulement 40 hectares, disséminés en 84
parcelles, destinés au pacage du bétail. Dans ce voisinage des bourgs, les
parcelles forestières sont concentrées dans les sections du Bourg 83 pièces autour des bois du
Bourg et de la
Ruade, de Meyran
(22 ha.), de Mestras (37) et de la Magdeleine (52) alors que les grosses
propriétés sont cantonnées, on l’a vu, dans la lande ou vers La
Hume.
A ce total de 255 hectares, il faut en ajouter
42 « de pins et landes »,
plantations qui sont vraisemblablement moins denses et de « bois »
non caractérisés 6 à Taurès et 26 au
lieu-dit Techoueyres qui appartiennent à la Compagnie
agricole (10) et à Daussy (11).
Quant aux semis, il n’y en a que
4 hectares partagés entre 6
personnes, ce qui confirme l’impression de stagnation déjà soulignée et qu’on
retrouve dans le pourcentage par rapport à la superficie de la commune, des
pins (5,54 %) et des landes (76,71 %).
En effet, les 3135 hectares de landes privées ne
seront boisés qu’après la suppression des droits de parcours détenus depuis
1550 par les habitants. Cela fut accepté par la commune en1864 contre la somme
de 50000 francs payée par M. Lescanne Perdoux qui venait d’acheter une partie
des landes de Nezer, issues de
la liquidation de la Compagnie
Agricole.
Il en fut de même à La Teste, grâce à
une procédure de cantonnement qui permit à la commune de récupérer 370 hectares sur le territoire de
sa voisine. Cependant, l’obstination des habitants de Cazaux à faire respecter
leurs droits repoussa la possibilité de semer des pins jusqu’en 2901 quand la
commune, pour régler le problème, racheta les landes Lescanne situées près du village. Ces suppressions de
droits qui portaient sur m 4226 hectares du
« cantonnement Lescanne » furent complétés par des accords semblables
avec les autres acquéreurs des terrains de la compagnie agricole et leurs
ayant-droits. Ils portèrent sur 984 hectares si bien qu’en 1919,
le total des superficies cantonnées sur les deux communes était de 521O
hectares.
LE TEICH : La situation y
est très différente puisque l’ensemble des surfaces boisées représente 51,44 %
de la superficie de la commune voire 54,20 % si on enlève la section dite des prés salés où l’on trouve
cependant 17 hectares de « bois » dont 6 de pins.
Ces forêts se répartissent en 475 ha. de « bois » (5 ,50%), 84 de taillis, 55 de bois et marais inondés, le long de la Leyre, et
surtout 3288 hectares de « pins et landes » (7,26%).
Ces dernières correspondent aux
propriétés de la compagnie d’Arcachon, héritière de Nezer (environ 3000 hectares alors qu’à l’origine il n’y en
avait que 575), à celle d’Hirigoyen (659) et de Festugière, propriétaire du
château de Ruat. Le reste est divisé en
234 parcelles dont 23 seulement sont supérieure à 1 hectare.
Quant aux 475 hectares de
« bois », 49 relèvent de la commune et 181 appartiennent à Festugière
surtout à Lamothe (Fontaine Saint Jean et la berle du
tchan), sans oublier les bois d’agrément qui s’étendent sur 5,5 ha autour du manoir, et 3 dans
le bois de Comps. Le reste est divisé
en 177 parcelles très éparpillées, sauf dans les secteurs de Comps et du Bouscaut ainsi qu’à l’est, vers la Leyre. C’est
là que se trouvent les 16 parcelles supérieures à 1 hectare partagées entre 6
familles (Techoueyres, Mesplé, Daney, Fourton, Lafourcade et Villetorte).
La commune du Teich, présente
donc un visage très différent de celui de sa voisine Gujan, surtout à cause de
sa situation géographique (la présence de la rivière), historique (celle
du château de Ruat) et sociale (absence de droits d’usage sur la lande). A coté
des zones humides naturellement boisées et de la multiplication de petites
parcelles proches du bourg, cela a permis la constitution de très grandes
propriétés forestières où la culture du pin est déjà très
« moderne ».
Cette tradition forestière qui
se retrouve aussi à La Teste, mais pour d’autres raisons (forêt usagère et
semis sur dunes) a en partie façonné les mentalités et guidé l’action des
municipalités. Elle ne se retrouve pas à Gujan où la forêt est plus récente.
Pour l’ensemble du canton, la situation,
en 1852 se présente ainsi :
-14675 hectares de forêts dont
9033 à l’Etat (les semis sur dunes) et 5672 sur les anciennes landes
auxquels il faut ajouter les 4183 ha de la Montagne
usagère de La Teste.
-13118 hectares de landes.
Les communes de la rive Est.
Par contre, pour les communes
qui s’étendent de Biganos à Lège, il n’y a pas eu de gros changements. Si la
superficie des forêts a augmenté depuis 1827, la lande est toujours
prépondérante, comme le montre le tableau suivant résultant, là aussi de
l’analyse des cadastres impériaux.
La première colonne indique la
superficie, arrondie, en hectares, la seconde, le pourcentage par rapport à la
commune.
|
Communes Taillis et futaie Bois de
pins
landes
bois
taillis
Biganos 417 5,56% 385 5,14 % 5624 74,98%
Audenge 549 6,78 299 3,69 6734 83,15
Lanton 404 3,00 289 2,15 12026 89,38
Andernos 39 1,77 251 11,40 1648 74,95
Ares 99 2,16 241 5,25 3893 84,79
Lège 30 1,30 44 1,90 2010 87,07
Le Porge 18 0,26 552 8,75 5732 85,34
|
En ce qui concerne la
répartition géographique et sociale des forêts de pins, on constate qu’elles
sont toujours situées dans les mêmes secteurs et que, si de grandes propriétés
forestières privées commencent à poindre, elles sont encore minoritaires.
A BIGANOS, les boisements en pins sont
toujours concentrés vers Lamothe
ainsi qu’au lieu-dit Les sauzes,
soit 5,14 % du territoire sur 168 parcelles.
A AUDENGE seules 16 parcelles
sur 106 sont supérieurs à 1 hectare et 2 propriétaires
seulement se distinguent De Boissières avec 13 hectares au lieu-dit la baraque et Garnung, 13 hectares à Lubec.
A LANTON, ce sont 27 parcelles
sur 218 qui dépassent 1 hectare dont 10 de plus de 10 hectares. On retrouve les sites
connus ; bois de Lanton, de Taussat,
Pas du Rey, Le Renet, La Montagne…Trois
propriétaires y totalisent des superficies importantes : De Boissières (10 ha. au Pas Simonet) Argilas (63 au bois
de Taussat) et surtout Hazera (5,5 dont 7 au bois de Bénédict et le reste à la Montagne).
A ANDERNOS, c’est M. De Sauvage,
acquéreur en des propriétés Hirribarne,
anciennement Belcier, qui avec 222 hectares, domine tous les autres,
ses pins poussent surtout dans la Montagne (193 ha.) et près du bourg
d’Andernos (29). En dehors de ces parcelles, il n’y en a que 4 qui dépassent 1 hectare.
A ARES qui vient, en 1851 de se
séparer d’Andernos, la situation est semblable : sur 49 parcelles, toutes à M. De Sauvage totalise
186 hectares en 4 parcelles à la Montagne (166) et à Arpech (20) et la Veuve Sutton,
avec 25 hectares en 3 parcelles, toutes à Arpech, est la seule autre propriétaire
importante. Quant au reste, il n’y a que 3 parcelles supérieures à 1 hectare.
A LEGE enfin, 10 parcelles de
pins dépassent l’hectare mais la plus grande n’atteint que 3,6 ha.et aucun des 8
propriétaires ne se distingue hormis les héritiers de Marbottin ; mais la
plus grande partie de leurs plantations est située dans les dunes et ils ne
possèdent que 6 hectares dans les anciennes
landes, au Bourgey et à La Saugeouse. Pour mémoire,
disons que les dunes couvertes ne représentent alors que 36 ha. et qu’il y a encore 3366 ha.de sables blancs.
Pour l’ensemble du canton
d’Audenge, il y a, en 1852, 9800 hectares de forêts et 42768
de landes auxquelles il faut ajouter 984 hectares pour le foin, et 955
de pâturages.
Au PORGE, il n’y avait, lors de
la confection du premier cadastre en 1827, que 6 parcelles de pins dépassant 5
hectares ; la plus grande en avait 8, quatre appartenaient au sieur Brun
et les deux autres au sieur Laguayte. Même situation pour la lande avec une
seule parcelle importante de 16 hectares.
Les communes du Val de Leyre.
Pour les deux communes de Mios
et de Salles, la répartition de la
couverture végétale est la suivante :
|
Communes bois taillis et
futaie bois de
pins taillis
et landes landes
landes
et pins
Salles 873 6,40% 2722 19,80% 73 0,53% 8071 59,24%
Mios 885 6,61 433 2,57 563 4,35 9982 77,34
|
La encore, la part des landes
est prépondérante, surtout à Mios ; les tableaux suivants donnent la
répartition, par section, en pourcentage de la superficie totale, avec, en
italiques le nombre de parcelles
|
SALLES, sections bois taillis pins
landes
A (du Bougès 21,7 84 25,10 119 16,3 121
B (d’Argilas) 17,8 308 6,25 99 57,9 281
C (de Vignolles) 1,7 72 13,90 281 72,5 185
D (de Badet) 2,9 68 16,50 209 75,4 220
E ‘du Bourg) 22,9 101 8,50 55 28,5 54
F (de Lanot) 7,9 90 57,10 47 14,4 99
G (de Peyreherine) 0 0 5,50 78 93 45
H (de Caplanne) 3,2 82 31,80 385 55,4 156
_______________________________________________________________________________________________
MIOS
A (Ramounet) 4,86 117 2,28 94 86,77 217
B (Lillet) 28,63 507 2,52 51 31,99 446
C (Bourg) 4,68 585 4,86 260 76,44 1273
D (Caudos) 5,78 429
1,97 104 86,40 708
|
Pour Salles, si l’on compare
avec la répartition des forêts au XVIII° siècle (carte de Belleyme) on constate
qu’elles se sont un peu développées dans les quartiers de Lavignolle et du Bougès où
elles étaient pratiquement inexistantes, qu’elles ont bien progressé dans celui
de Caplanne mais que l’essentiel est
encore constitué par la Montagne.
A Mios la part des forêts est
beaucoup plus faible et aucune partie de la commune ne se distingue par la
présence de forêts importantes.
A Salles, la répartition des parcelles
selon la végétation est la
suivante ;
|
Végétation nombre de
parcelles superficie
moyenne des parcelles
Bois taillis
804 1,08 hectares
Pins
1628
1,67
Lande
1151
7,01
|
En ce qui concerne
les seuls bois de pins, nous obtenons les chiffres suivants :
Superficie nombre de parcelles Propriétaires importants
1 à 5 ha. 456
5 à 10 59
10 à 20 22
20 à 50 10 Cazauvielh(4), Dupuch
(2), Comte de Puységur (1)
50 à 100 2 Puységur (2)
+
100 2 Dupuch et Puységur qui,
avec 462 ha. est le plus gros
propriétaire de la commune.
A Mios, par contre, on constate que, dans l’ensemble, les
parcelles de pins sont petites, la moyenne des propriétés s’établissant
ainsi :
Moyenne des
superficies Section
A Section B Section C Section D
Des parcelles 0,75
ares 44 ares 1,00 ha. 74 ares
Par propriétaire 2,21 ha. 83 ares 2,70 ha 2 ha.
Parcelles de 1 à 3 ha 13 3 29 19
« 3 à 5 ha. 0 0 8 0
+ 5 ha. 0 0 5 0
Il n’y a donc pas beaucoup de gros propriétaires et très peu
de propriétés d’un seul tenant. Ainsi, en Section A, Taudin, dit Lachaume,
totalise un peu plus de 8 hectares en 13 parcelles dont 2 > 1 hectare. En section C, Courbin Pierre possède environ 16 hectares en 13 parcelles dont 4 > 1 ha. deux d’entre elles, totalisant 10 ha. se trouvent au Hourquet et voisinent celles de Lafon, dit Hillot, (8 ha.) et d’Hazera (4 ha). En section, D enfin, la propriété de
Ducos (7,5 ha.) est divisée en19 parcelles dont 3> 1 hectare.
On constate donc qu’au milieu du XIX° siècle, les landes du
Pays de Buch ne sont pas encore sauf exceptions, couvertes comme de nos jours
de forêts. Ce n’est que dans la seconde
moitié du siècle, grâce à des initiatives privées et surtout à l’engagement du
pouvoir politique et de Napoléon III que les forêts de pins se développeront.
Ce sont en effet les lois de 1857 qui donneront l’élan décisif en obligeant les
communes à semer en pins leurs communaux.
6 INITIATIVES
PRIVEES ET INTERVENTION DE L’ETAT.
Avant même que l’Etat intervienne en 1857, des initiatives
privées avaient déjà contribué au boisement de la lande ; trois noms
dominent ces entreprises :
-François et Ernest
Valeton de Boissière.
François, négociant à Bordeaux, est propriétaire du domaine
de Certes depuis 1818 : 1879 hectares achetés à Dauberval
qui les avait acquis en l’an 6. Il leur ajoute en 1839 les 113 ha. (ou 200 en 1837 selon une
autre source) de la propriété Walbreck, négociant parisien qui avait acquis en
l’an 3 les réservoirs à poisson de la veuve de Nicolas Guesnon de Bonneuil. Son
fils Ernest augmenta la superficie des
surfaces plantées en pins puisque le domaine qui en compte 298 ha. sur les cadastres
impériaux, passe à 350 en 1855, puis, 10 ans plus tard à 600 hectares de pins et 1100 de
landes. Ces plantations commencèrent vers 1843/44 grâce aux travaux
d’assainissement commencés par François.
Il s’agissait de délimiter, par un fossé continu, un
quadrilatère de 200 sur 300 mètres et de creuser, à
l’intérieur, à 5 mètres du fossé Est, des fossés
de 2 mètres de large distants de 12 mètres qui s’écoulaient dans le
fossé Ouest. Cette technique dite des platebandes
n’a pas été la seule à être expérimentée puisqu’ailleurs, vers Audenge, les
fossés sont distants de 100 mètres ou bien creusés en dents de peigne en direction du fossé central.
-Javal :
banquier parisien, il achète en 1847, à David Allègre, 1910 hectares à Ares. (il s’agit
de l’ancien domaine Belcier), en 1833, il profite de la déconfiture de la Compagnie
Balguerie, (qui avait acheté les terres du Marquis Antoine
des Marons de Sauvage, neveu du Duc Decazes)
pour y ajouter 1039 de landes sur le territoire de Lège.
En 1860, il se trouve ainsi à la tête de
-501 ha. de vieux pins, déjà
gemmés en 1815
-81 ha.de pins plantés en 1845
-1940 ha. de semis de 1 à 5 ans
-et 150 ha. de landes .
89% de ses landes ont donc été converties en pins et 6% en
cultures. Cette réussite lui vaut en 1860, la médaille d’or du Concours
agricole de Paris. Cette réussite a été, là aussi, permise par le creusement de
165 kilomètres de fossés.
Ce domaine Javal passera ensuite aux mains de sa fille,
épouse Wallenstein, puis donnera naissance, en 1919, à la Société
Forestière de la Saussouze (1919 ha de pins plus le bois de Pitchoury (720 ha.) et les pins de Digneau (125 ha acquis en 1919) et au
Domaine d’Ares (659 ha.)
-Pereire :
ce banquier, fondateur de la Compagnie
du Chemin de Fer du Midi ( et créateur de la Ville d’Hiver
d’Arcachon) achète en 1852 les propriétés que la famille De Tracy possédait à
Lanton (5166 ha.), Audenge(1500),Biganos
(703),Biganos(702) et Mios (2521), puis, en 1857, après l’échec de la compagnie d’Arcachon,1158 ha. au Teich et quelques 273 ha. supplémentaires entre 1862
et 1872.
Ces propriétés, traversées par la voie ferrée, forment alors
deux domaines plantés en pins ;
-le domaine de
Marcheprime (8435 ha. à Biganos(1015), Mios
(913), Audenge(1460) et Lanton(5044)
-le domaine de Caudos :
2885 ha à Mios (1529) et au Teich
(1355).
Auxquels s’ajoutent celui de Cestas (107 ha.). Gravement incendiés
entre 1864 et 1870 (6262 ha détruits), ils furent
ensuite reconstitués puis vendus en 1917.
Après avoir imaginé un système de drainage enterré, Pereire
appliqua les techniques préconisées par l’ingénieur Crouzot, Chef du service
Hydraulique des Landes.
Ces « étrangers » contribuèrent donc pour une très
grande part au boisement de la lande, développant à grande échelle des
techniques d’assainissement
déjà connues mais peu employées jusque là. Cette entreprise,
réservée jusque là aux terrains privés, fut encore amplifiée lorsque l’Etat
décida, à son tour, de la prendre en charge, ou plutôt de la faire prendre en
charge par les collectivités locales.
C’était d’ailleurs l’aboutissement d’une longue tradition
d’efforts menés, on l’a vu, sans succès, par les administrations régionales au
XVIII° siècle et poursuivis ensuite à preuve les circulaires du baron d’Haussez,
demandant aux communes, dès 1817, alors qu’il était Préfet des Landes, de
réserver chacune 30 hectares de leurs vacants à la
plantation des pins.
La loi du 19 Juin 1857, enjoignit en effet aux communes, ou
à l’Etat, en cas de défaillance de ces dernières, d’assainir, ensemencer ou
planter en bois, à leurs frais, les terrains communaux soumis au parcours du
bétail.
Il fut aussi prévu de créer un réseau de routes
agricoles : c’est ainsi que furent réalisés les axes Facture-Ares,
Facture-Beliet, La Hume-Sanguinet, Caudos-Salles et Lugos-Belin.
De plus le 10 juin 1854, une loi avait prévu toutes les
conditions nécessaires à la réalisation d’un réseau de drainage.
 Enfin les communes obtenaient la
possibilité de vendre les terrains susceptibles d’être mis en culture afin de
financer leurs investissements publics.
Enfin les communes obtenaient la
possibilité de vendre les terrains susceptibles d’être mis en culture afin de
financer leurs investissements publics.
Ces textes permirent de parfaire la transformation bien
entamée des paysages mais il est difficile de connaître leur impact immédiat
sur les boisements tant les chiffres sont imprécis. Par exemple, ceux donnés
par Chambrelent sur la superficie des
landes communales en 1857, ne correspondent pas toujours à ceux qu’on trouve
dans les archives. Cependant un document, malheureusement non daté, mais qui,
par recoupements, doit être de 1858/59, donne, en hectares les chiffres
regroupés dans le tableau suivant (ceux qui sont signalés par* se retrouvent
dans les tableaux de Chambrelent, sinon les siens sont transcrits en italiques.)
Chambrelent
|
Communes étendue des
landes communales projet pour vendues en
Superficie totale
ensemencée
vendues 1860 1861
1877
Biganos 1263 (1105) 300 556
1058
Audenge 3156 (3516) 900 1132 1251
Lanton 4726* 0
1400 1746
Andernos 711* 150 232 240 245
Ares 1613 (1798)
425
530 115
Mios 2134 (2282) 700 167 550 853
Salles 4957* 1250
1250 2230
Le Teich 1277 201
Le Porge
3957
2142
|
Cela montre, malgré l’imprécision des chiffres, que la loi a
eu des effets rapides sur les ensemencements en pins. La conjoncture était
d’ailleurs favorable, l’âge de « l’arbre d’or » commençait, les cours
de la résine ayant fortement augmenté.
Quant aux parcelles vendues, elles ont été mises en culture
et cédées la plupart du temps en très petits lots afin de permettre au plus
grand nombre d’en acquérir. Deux exemples, à Biganos où 477 hectares sont en lots de 2 à 3 ha. chacun et à Ares où 76
parcelles sont inférieures à 4 hectares et 6 seulement
supérieures à 20. Même situation au Porge où seuls les
habitants de la commune purent acheter au pris de 50 à 60 francs l’hectare, ou
à crédit avec un intérêt de 5%, de petits lots proches de leurs habitations.
Ces dispositions ayant pour but de désarmer les oppositions des paysans qui
craignaient de manquer de pâturages.
Passer de la lande à la forêt fut donc un e entreprise de
longue haleine.
Comme toute entreprise d’aménagement du territoire, elle a eu besoin de
visionnaires, les précurseurs ; ils se sont heurtés aux habitudes et à
l’incrédulité et sont restés parfois oubliés car ils ne possédaient l’art ni
les moyens de, comme on dit aujourd’hui, médiatiser leurs idées et n’étaient
pas toujours dans les allées du pouvoir (Desbiey, Villers..).
Il a aussi fallu une évolution des mentalités et de la
législation : lois révolutionnaires de 1792,1793 et
« impériales » de 1904,1854 et 1857 ; mais il a fallu aussi des
conditions économiques favorables, ainsi la barrique de résine valait en
monnaie constante 23 francs en 1816,43 en 1840,55 en 1854 et 68 en 1857.
Enfin cela ne put se faire sans l’engagement de l’Etat, de
ses administrateurs (Boutin, Tourny, Dupré de Saint Maur, le Baron d’Haussez)
des ses ingénieurs ‘Crouzet, Deschamps, Chambrelent) et parfois pour briser les
dernières résistances du pouvoir politique (Napoléon III) afin de parachever le
tout et de consacrer, par la loi, la nouvelle situation.
Il est d’ailleurs remarquable que cet engagement ait été
constant depuis le XVIII° siècle, quels que soient les régimes politiques.
Il en sera de même pour l’autre volet de cette révolution
forestière, la fixation et la plantation des dunes.





 noms :
noms :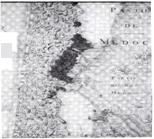
 -au Porge où la famille de Verthamon
-au Porge où la famille de Verthamon

 sud du Broustey.
Puis, dans la seigneurie de Certes
sud du Broustey.
Puis, dans la seigneurie de Certes .
.
 un petit pinhadar.
un petit pinhadar.

 Comte
de Montauzier auquel est associé
Clavaux (1773), ce projet appuyé par Desbiey fut refusé par Brémontier qui,
depuis 1770, était en poste à Bordeaux ; la lecture en séance publique de
l’Académie de Bordeaux du mémoire des frères Louis Mathieu et Guillaume Desbiey « Sur l’origine des sables de nos côtes et les moyens de les
fixer » ; le projet d’un canal de Bègles à Arcachon par Péconnet (1775) qui reçut un avis
défavorable de Turgot ; le mémoire de Guillaume
Desbiey « Sur la meilleure
manière de tirer parti des landes de Bordeaux » (1776) ; celui de
Lorthe sur un
Comte
de Montauzier auquel est associé
Clavaux (1773), ce projet appuyé par Desbiey fut refusé par Brémontier qui,
depuis 1770, était en poste à Bordeaux ; la lecture en séance publique de
l’Académie de Bordeaux du mémoire des frères Louis Mathieu et Guillaume Desbiey « Sur l’origine des sables de nos côtes et les moyens de les
fixer » ; le projet d’un canal de Bègles à Arcachon par Péconnet (1775) qui reçut un avis
défavorable de Turgot ; le mémoire de Guillaume
Desbiey « Sur la meilleure
manière de tirer parti des landes de Bordeaux » (1776) ; celui de
Lorthe sur un aussi le cas dans les
aussi le cas dans les  Enfin les communes obtenaient la
possibilité de vendre les terrains susceptibles d’être mis en culture afin de
financer leurs investissements publics.
Enfin les communes obtenaient la
possibilité de vendre les terrains susceptibles d’être mis en culture afin de
financer leurs investissements publics.